
Cyril le Grix, président
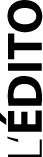
|
Face au climat asphyxiant et nauséabond dans lequel nous ont plongé les résultats des élections européennes du dimanche 9 juin, le Syndicat National des Metteuses et Metteurs en Scène appelle, aux côtés des autres syndicats de la Fédération de la CGT Spectacle, à une mobilisation collective qui seule permettra de lutter efficacement contre les idées de haine et de violence de l’extrême droite.
Le SNMS réaffirme haut et fort que l’idéologie d’extrême droite menace violemment la démocratie dans toute l’Europe, porte atteinte aux droits humains et reste incompatible avec nos valeurs républicaines fondamentales.
Si en tant que citoyens et artistes, nous comprenons et partageons la colère qui monte depuis plusieurs années dans notre pays, le vote en faveur de l’extrême droite ne sera jamais une solution. Au contraire, son programme est une vaste mystification qui va à l’encontre des droits et des intérêts de celles et ceux qu’elle prétend défendre.
Malgré ce contexte, nous, metteuses et metteurs en scène comme nombre de citoyens, refusons de nous résigner face à l'extrême droite.
Ce séisme politique annoncé n’est pas une fatalité. A l’idée de ce que pourrait devenir notre pays au soir du 7 juillet prochain avec une majorité d’extrême droite élue à l’Assemblée nationale, nous devons agir pour enrayer la progression de ce fléau. Les trois semaines à venir seront décisives.
Aussi nous vous donnons rendez-vous dès le jeudi 13 juin à 14h30 devant l’Ecole Nationale d’Architecture, 60 boulevard de la Villette pour une première mobilisation que nous espérons la plus large possible pour défendre notre démocratie.
Face au climat asphyxiant et nauséabond dans lequel nous ont plongé les résultats des élections européennes du dimanche 9 juin, le Syndicat National des Metteuses et Metteurs en Scène appelle, aux côtés des autres syndicats de la Fédération de la CGT Spectacle, à une mobilisation collective qui seule permettra de lutter efficacement contre les idées de haine et de violence de l’extrême droite.
Le SNMS réaffirme haut et fort que l’idéologie d’extrême droite menace violemment la démocratie dans toute l’Europe, porte atteinte aux droits humains et reste incompatible avec nos valeurs républicaines fondamentales.
Si en tant que citoyens et artistes, nous comprenons et partageons la colère qui monte depuis plusieurs années dans notre pays, le vote en faveur de l’extrême droite ne sera jamais une solution. Au contraire, son programme est une vaste mystification qui va à l’encontre des droits et des intérêts de celles et ceux qu’elle prétend défendre.
Malgré ce contexte, nous, metteuses et metteurs en scène comme nombre de citoyens, refusons de nous résigner face à l'extrême droite.
Ce séisme politique annoncé n’est pas une fatalité. A l’idée de ce que pourrait devenir notre pays au soir du 7 juillet prochain avec une majorité d’extrême droite élue à l’Assemblée nationale, nous devons agir pour enrayer la progression de ce fléau. Les trois semaines à venir seront décisives.
Aussi nous vous donnons rendez-vous dès le jeudi 13 juin à 14h30 devant l’Ecole Nationale d’Architecture, 60 boulevard de la Villette pour une première mobilisation que nous espérons la plus large possible pour défendre notre démocratie.
... continuer la lecture de l'édito
réduire
|
Actus du SNMS
actu du 18/07/2024
𝐍𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞́𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 : 𝐭𝐫𝐨𝐢𝐬 𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬
actu du 12/07/2024
Les Assises Nationales de la Mise en Scène
actu du 15/03/2024
Annulation de crédits : expression commune de la branche CCNEAC au CNPS de mars 2024
actu du 29/01/2024
Informelle du 5 février
actu du 19/01/2024
Retour du SNMS à la CGT Spectacle
actu du 11/10/2023
Décès de Jorge Lavelli
actu du 09/10/2023
Osez les autrices - octobre 2023
actu du 24/07/2023
Faut-il encore payer les artistes ? En écoute !
actu du 10/07/2023
Le SNMS à Avignon !
actu du 22/05/2023
Hommage à Colette Nucci
actu - Stéphane Daurat
TOUTES LES CHOSES GÉNIALES
actu - Stéphane Daurat
L'HOMME QUI DORT
actu - Stéphane Daurat
LES LAURIERS ROSES
actu - Stéphane Daurat
APRÈS LE CHAOS
actu - Eva Schumacher
Cyborg Experiment#1
actu - Marie Iasci
ET SI ON S'AIMAIT ?
actu - Camille Roy
Les Fourberies de Scapin
actu - Camille Roy
TEMPÊTE

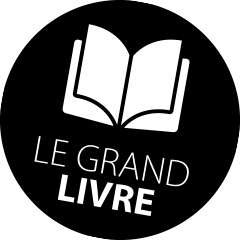
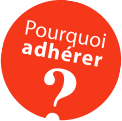


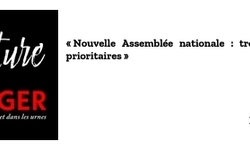

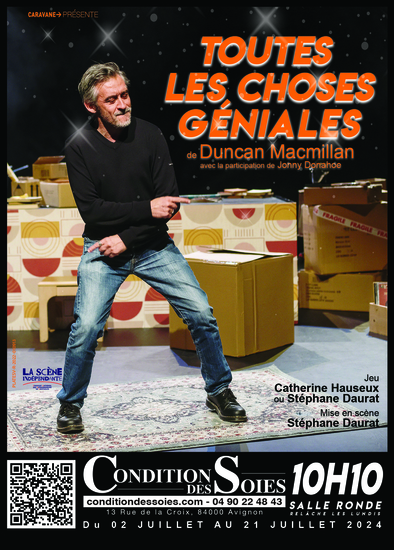



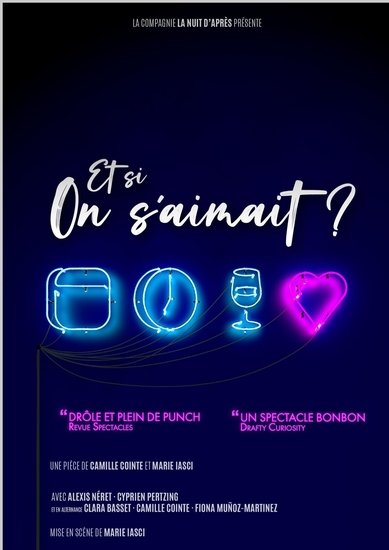

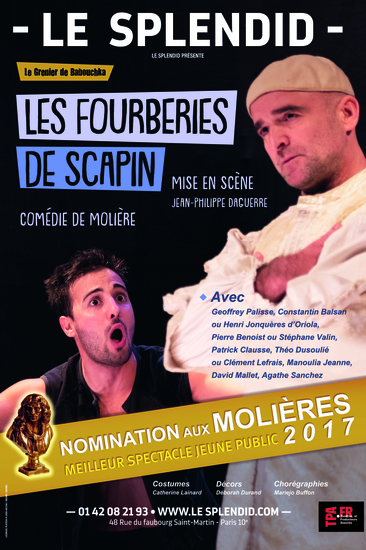


 Inscription à la
Inscription à la